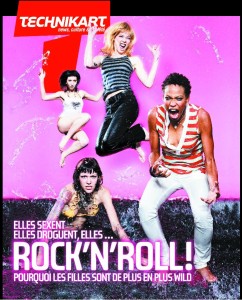Il y a quinze ans, il hurlait dans le micro du groupe White Zombie. Aujourd’hui, son deuxième long-métrage, «The Devil’s Rejects», est un polar baigné de violence 70’s. Rob Zombie, le nouveau héros du contre-cinéma US, est une hard rock star.
Cummings. Robert Cummings. En général, les pseudos idiots et les alter ego rigolos ne survivent pas à l’orgueil de la signature. Quand on passe cinéaste, il faut être soi-même, cesser de s’appeler « Beat » Takeshi ou « Zabou », pour redevenir Takeshi Kitano ou Madame Breitman, question de dignité. Lui est né Cummings, il y a quarante ans. Quand il a fondé son groupe de hard rock, White Zombie, et choisi son nom de scène sous influence Ramones et Romero, à peine vingt ans avaient passé, l’âge des erreurs de jeunesse qu’on s’efforce de corriger par la suite. Pas lui.
« Ecrit et réalisé par Rob Zombie » : sur le commentaire audio du DVD US, on l’entend gémir de plaisir et de fierté. Simplement parce que c’est bien de lui qu’il s’agit : peut-être pas de son vrai nom, mais de sa véritable identité, même si « Quand je revois des photos de l’époque White Zombie, j’ai parfois l’impression que c’était une autre vie, presque une autre personne ». Vraiment ?
La tignasse et la barbe Charles Manson sont toujours là, pas bougées, juste blondies pour le disque solo (le premier en cinq ans) et la tournée US en cours. Les vilains muscles, les lunettes noires, la bière plein le bide, les tatouages menaçants sur les bras et la voix du fond de l’enfer, aussi. Pas un journaliste qui le rencontre n’évite les remarques du style « Moins méchant qu’il n’en a l’air » ou « C’est vrai qu’il fait un peu peur, mais il ne ferait pas de mal à une mouche », ce qu’on se gardera bien de vérifier.
Comme musicien, Rob Zombie joue dans la cour des fous furieux. Le rock est lourd (heavy) : tempos lents, groove qui tronçonne les tympans, guitares trépanantes, presque grunge, avec touches indus et démences soniques pré-Marylin Manson, sans oublier des samples de musiques, dialogues et bruitages de films d’horreur dans tous les coins du casque. Une sorte d’hybride entre ringardise absolue (le metal con des années 70/80) et compréhension instinctive de la génération MTV (le groupe doit son succès aux passages en boucle chez Beavies & Butthead dans la première moitié des 90’s)
A ses débuts, déjà, Rob Zombie est autre chose qu’un simple hurleur tatoué, réalisant lui-même ses pochettes cartoons et la totalité de ses clips. « Mon label voulait toujours me maquer avec tel ou tel clippeur, explique ce sympathique chevelu. A chaque fois,je répondais : “Aucune chance que je confie ma carrière aux mains de ce pied-tendre.”Moi, quand j’étais gamin, ma vie était de la merde, point barre. Je n’ai pas fait ce métier par cynisme, comme on me l’a parfois reproché à mes débuts. J’étais on ne peut plus sincère : le metal est une musique qui accompagne un style de vie. »
Il fallait donc comprendre le nom White Zombie non seulement comme une citation cinéphile pointue (le premier film de mort-vivant répertorié, un Bela Lugosi de 1932) mais encore comme l’indication d’une démarche white trash, assumée, revendiquée, avec double fixette sur les années 70 et les serial killers. Ce qui nous mène direct au cinéma.
« En musique, en BD, en cinoche, les 70’s sont ma période favorite. Je ne fais qu’y revenir encore et encore. » Dans une interview à un site américain, il précisait : « Jour après jour, je voyais Taxi Driver, les Dents de la mer, le Parrain ou Rencontre du 3e type. Chaque week-end, mon esprit explosait. J’avais sans doute l’âge d’être plus réceptif, mais je n’ai pas l’impression de ressentir ça souvent dans les salles de cinoche ces jours-ci. »
Tourné en 2003, le premier film de Zombie, la Maison des 1000 morts, est un nanar d’horreur abusivement comparé à Massacre à la tronçonneuse (le cauchemar  texan, le visage écorché transformé en masque) mais adoubé par Tobe Hooper en personne. On y découvre la famille Firefly (lucioles), une bande de rednecks dégénérés (un grand brûlé demeuré, une bimbo nymphomane tueuse, un clown assassin, un albinos sataniste, voir encadré), partageant le goût du meurtre et « des dents complètement pourries ! », se marre Zombie. Jusque-là, pas de problème : depuis Alice Cooper et Kiss, on a l’habitude de considérer cinéma d’horreur et hard rock comme des frères de sang.
texan, le visage écorché transformé en masque) mais adoubé par Tobe Hooper en personne. On y découvre la famille Firefly (lucioles), une bande de rednecks dégénérés (un grand brûlé demeuré, une bimbo nymphomane tueuse, un clown assassin, un albinos sataniste, voir encadré), partageant le goût du meurtre et « des dents complètement pourries ! », se marre Zombie. Jusque-là, pas de problème : depuis Alice Cooper et Kiss, on a l’habitude de considérer cinéma d’horreur et hard rock comme des frères de sang.
Mais pour The Devil’s Rejects, son long-métrage actuellement à l’affiche, l’amalgame ne fonctionne plus : « Dans les années 70, tu avais un petit truc indé comme Massacre à la tronçonneuse, mais les gros studios sortaient eux aussi des films comme l’Exorciste, Orange mécanique, Rosemary’s Baby. Ensuite, des personnages comme Jason ou Freddy ont amené une approche plus facile à regarder. En reprenant les héros de la Maison des 1000 morts, je savais que ça pouvait dégénérer dans un truc barré mais finalement, inoffensif. Alors, j’ai décidé de faire le contraire, de virer tous les aspects extravagants et de revenir à un truc basique, plus dur.”
Situé en 1978 (c’est-à-dire moins dans les années 70 qu’avant les années 80), The Devil’s Rejects est un choc de fun viscéral comme le cinoche américain n’en génère plus aucun. Du culte à l’état pur, débarrassé de la hype et du marketing à la Tarantino. On y croise des signes en provenance de Bonnie & Clyde, l’Epreuve de force ou Sam Peckinpah (le générique surexcitant bourré d’arrêts sur image), qui forment une sorte d’anthologie du cinoche redneck,où régneraient l’imagerie Hell’s Angels, les étendues de désert, les motels cheaps et le southern rock.
La façon dont The Devil’s Rejects se présente comme la suite directe du précédent tout en incarnant son contraire parfait, est sans équivalent connu. Le look a changé (passé d’une esthétique de parc d’attractions gothique à une approche de western moderne surviolent), le ton a été bouleversé (le malaise et l’empathie pour les victimes remplacent la torture potache) et le genre lui-même a explosé (du horror movie classique au thriller 70’s). « Ça, c’est parce que je déteste les suites. Les suites, en général, c’est la même histoire avec un “2” dans le titre. Là, ce n’est pas la même histoire. Ça s’appelle The Devil’s Rejects et c’est un film à part entière. »
On repense aux hardeux rencontrés dans les années 80. Leur fantasme à eux, c’était les guitares, les six cordes, l’équivalent des six coups des fans de western. Un groupe comme Lynyrd Skynyrd n’avait rien de hard (du rock marécageux stonien et mélodique), mais ses membres étaient durs et ils avaient quatre guitares. Des mecs dangereux qui avançaient en gangs, buvaient comme des trous, passaient leur temps à se battre et avaient, pour certains, fini démembrés et décapités en 1977 à la suite d’un crash d’avion entré dans la légende du rock’n’roll.
Leurs deux chansons clés : l’hymne redneck Sweet Home Alabama et le symbole outlaw Free Bird, titre de neuf minutes sur lequel Rob Zombie a écrit, tourné et monté l’intégralité de son « shootout » final, un morceau de bravoure monstrueux où la famille Firefly charge un barrage de flics en défouraillant depuis sa décapotable. « C’est une chanson énorme, massive, qui exprime un truc éternel et ambigu sur la liberté », explique le metteur en scène.
Faut admettre que la fausse piste était énorme : la suite de la Maison des 1000 morts a beau être un film de Zombie titré The Devil’s Rejects (qu’on pourrait traduire par « Même le Diable n’en voudrait pas »), il ne s’agit ni d’un film gore, ni d’une série Z horrifique, mais d’une hypothèse dégénérée de cinéma sudiste. Il l’aurait signé Robert Cummings, on ne se serait même pas posé la question.
«LA MAISON DES 1000 MORTS»: EN DVD (METROPOLITAN).
«THE DEVIL’S REJECTS», SORTIE LE 19 JUILLET.
LÉONARD HADDAD
Paru dans Technikart #104, juillet/août 2006